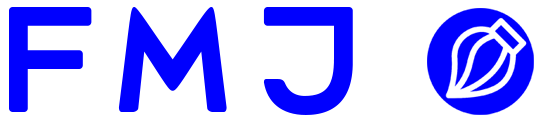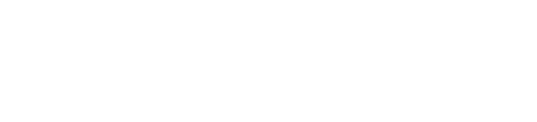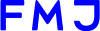De la forêt au désert, de la glace aux grandes plaines, certains artistes ne peignent plus le paysage : ils le façonnent, l’écoutent, le laissent agir. Loin de l’alcôve qu’est l’atelier, l’artiste se dévoile sous le ciel et s’inspire de la matière vivante du monde. Entre art et écologie, poésie et conscience, la nature devient à la fois sujet, outil et partenaire de création.
Sortir de l’atelier
Il fut un temps où l’artiste observait la nature depuis la fenêtre de son atelier. Le paysage entrait dans le cadre, apprivoisé par la toile, discipliné par le pinceau. Puis vint une génération qui décida de franchir le seuil et de ne plus peindre les arbres, mais de travailler avec eux, de ne plus regarder la rivière, mais de la laisser modeler la forme.
Au tournant des années 1970, les artistes du Land Art — Robert Smithson, Nancy Holt, Richard Long — déplacèrent la création hors du musée, vers les espaces nus et le ciel ouvert. Le désert devint une galerie, la colline un atelier, le vent un instrument. Ce fut une manière d’élargir la pratique artistique à la dimension planétaire, mais aussi de retrouver un lien plus archaïque avec la terre. Depuis, cette impulsion n’a cessé de se renouveler.
À l’ère de la crise écologique, ce mouvement prend une autre profondeur : il ne s’agit plus seulement de liberté formelle, mais d’un geste de réconciliation. L’art devient une manière d’habiter le monde avec délicatesse.
 © Holtsmithson Foundation
© Holtsmithson Foundation Andy Goldsworthy, sculpteur du vent et du temps
Andy Goldsworthy travaille à mains nues, souvent seul, dans le silence des forêts d’Écosse. Il ne vient pas imposer sa présence : il écoute, observe, attend. Là, il assemble quelques feuilles cousues par des épines, érige un arc de pierre, tresse un cercle de branches ou de pétales. Rien d’artificiel, rien d’étranger au lieu. Ses matériaux sont ceux qu’il trouve sur place : mousse, glace, terre, sable et lichen.
Ses œuvres durent parfois quelques heures, parfois quelques minutes — et peuvent faire penser au mandala népalais, tibétain — le temps qu’un souffle les disperse, qu’une marée les emporte. Il les photographie avant qu’elles ne disparaissent, comme on garde trace d’un rêve au réveil. Cette fragilité est le cœur même de son art. Là où d’autres cherchent la permanence, l’artiste britannique choisit le passage. Ce qu’il sculpte, c’est le temps : l’érosion, la fonte, la chute, la dissolution.
Dans Rivers and Tides et Leaning into the Wind, les films que Thomas Riedelsheimer lui a consacré, on le voit patient, attentif, répétant les mêmes gestes jusqu’à ce que la nature accepte sa présence. Son œuvre semble une prière adressée au vent, une façon d’épouser le rythme du monde plutôt que de le contraindre. « Ce n’est pas la nature que je représente, dit-il, c’est elle qui m’enseigne la forme. »
Regarder ses créations, c’est redécouvrir la beauté des forces simples : la lumière, la gravité, le ruissellement. Ses œuvres ne dénoncent rien, elles révèlent la fragilité comme valeur, l’impermanence comme vérité.
 © Akos Kokai
© Akos Kokai Bande annonce du film ‘Leaning into the Wind’ (2017)
Ranjani Shettar, la vibration du monde
À plusieurs milliers de kilomètres de là, dans le sud de l’Inde, Ranjani Shettar tisse un lien tout aussi intime avec la nature. Ses sculptures suspendues semblent flotter entre deux souffles : celui du vent et celui de la matière. Bois, fil d’acier, cire d’abeille, pigments végétaux — ses matériaux viennent du monde vivant, choisis pour leur texture, leur mémoire, leur odeur parfois.
Chez elle, la nature n’est pas représentée : elle est transcrite sous forme de vibration. Seven ponds and a few raindrops, l’une de ses installations les plus emblématiques, évoque la pluie qui tombe sur l’eau, la propagation d’une onde, la répétition d’un motif fragile. On croit voir un organisme respirer.
Ses œuvres allient savoir-faire artisanal et intuition poétique : chaque nœud, chaque courbe est pensé comme un souffle. L’artiste ne cherche pas à figer le vivant, mais à en traduire l’élan. Ce n’est pas la nature vue, mais la nature ressentie ; celle qui circule, tremble, se répand.
Dans ses ateliers du Karnataka, l’artiste indienne travaille lentement, avec la même attention qu’un tisserand ou qu’un musicien accordant son instrument. Sa pratique est une écologie du geste. Elle est respectueuse, méticuleuse, consciente du cycle de la matière. Elle rappelle également que la beauté peut être un mode de résistance face à la vitesse du monde.
Introduction au travail artistique de Ranjani Shettar
Dialoguer avec la terre
Giuseppe Penone, figure majeure de l’Arte Povera, a fait du dialogue entre le corps et l’arbre l’un des axes centraux de son œuvre. Ses sculptures révèlent, à l’intérieur d’un tronc massif, le jeune arbre qu’il fut — comme si la mémoire du vivant dormait sous la matière. En suivant les nervures du bois, Penone restitue au végétal son histoire. Dans d’autres œuvres, il imprime sur la surface de l’écorce l’empreinte de sa main : geste d’humilité, presque de fraternité.
Nils-Udo, de son côté, plante des fleurs, creuse des bassins, bâtit des nids géants à même le sol. Ses installations, souvent éphémères, ne laissent qu’une trace photographique. « Je ne veux pas conquérir la nature, mais coopérer avec elle. »
herman de vries, enfin, collecte des sols, des feuilles, des fragments de terre qu’il classe, expose et nomme. Chaque prélèvement devient un poème géologique. Par cette accumulation silencieuse, il compose un herbier universel, une cartographie sensible du monde.
Ces artistes partagent un même refus de la domination. Leur travail n’est pas un acte de possession mais de conversation. L’œuvre n’est pas là pour transformer la nature en objet esthétique, mais pour révéler ce qu’elle nous apprend : la lenteur, la répétition, la patience, l’équilibre.
 © Nils-Udo
© Nils-Udo L’écologie comme esthétique
Ces pratiques, qu’elles soient méditatives, artisanales ou monumentales, ont en commun d’incarner une autre relation au monde. Là où la modernité a souvent opposé culture et nature, elles rétablissent une continuité. Créer, ici, ne consiste pas à prélever ou à consommer : c’est participer à un cycle, avec humilité.
L’art écologique ne se limite pas à son sujet — il réside dans sa méthode. Utiliser des matériaux locaux, recyclés, biodégradables ; accepter que l’œuvre se modifie avec le temps ; repenser la notion même de conservation — tout cela relève d’une esthétique de la durabilité.
Mais au-delà du geste écologique, il y a une quête spirituelle : celle d’une beauté non conquise, d’une œuvre qui ne s’impose pas.
Dans un monde saturé d’images et de production, ces artistes ralentissent le temps. Ils transforment le regard, invitant à une expérience de l’attention : écouter le vent dans les branches, suivre la coulée d’un ruisseau, observer le lent travail de la mousse sur la pierre. Leur œuvre n’est pas tant un objet qu’un état d’esprit.
Vers une poétique du vivant
Quand la nature devient atelier, la frontière entre création et existence s’efface. L’artiste ne fabrique plus une forme : il accompagne un processus. La main humaine se fait complice des forces naturelles — la gravité, la germination, la métamorphose.
Ces œuvres sont moins à contempler qu’à habiter. Elles ne racontent pas le monde, elles nous y replacent. Elles rappellent aussi que l’art n’est pas extérieur au vivant, mais une manière de le prolonger. L’arbre, la pierre, la pluie, la lumière deviennent des collaborateurs silencieux ; en quelque sorte des coauteurs. L’œuvre n’est pas contre la nature, mais avec elle.
L’art comme apprentissage de lenteur
Regarder une installation de Ranjani Shettar suspendue dans la lumière, ou un arc de pierres d’Andy Goldsworthy avant qu’il ne s’effondre, c’est mesurer le passage du temps. On y retrouve cette émotion première, quasi naïve, devant le monde : celle qui précède les mots.
Et dans un univers technologique où tout s’accélère, où la création se dématérialise, ces artistes réhabilitent le corps, le souffle, le temps qui passe. Leur pratique n’est pas nostalgique, elle est prospective et nous propose d’autres manières d’être au monde, plus attentives et réciproques.
La fragilité de leurs œuvres n’est pas un défaut : c’est leur vérité. Elles ne prétendent pas durer, mais témoigner d’un passage ; celui de l’eau, du vent, de la main, du regard. En somme, la beauté n’est pas ce qui résiste au temps, mais ce qui le traverse.
Quand la nature devient l’atelier, elle ne se soumet plus à la création, elle en devient la matrice. Et peut-être est-ce là, dans ce dialogue patient entre l’homme et le vivant, que l’art retrouve son sens premier : celui d’un geste d’attention, une manière de dire au monde, simplement, « je te vois ».