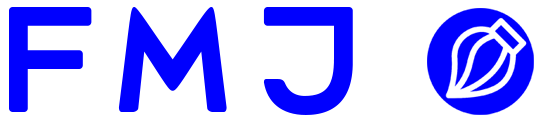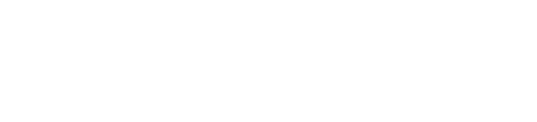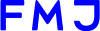Au panthéon des artistes dont l’œuvre défie les frontières et les classifications, Ryūichi Sakamoto, pour lequel nous avons une affection toute particulière par ses liens avec le septième art, tient une place à part. Musicien et compositeur japonais, dont la carrière s’est étendue sur cinq décennies, Ryūichi Sakamoto (1952–2023) a été à la fois un musicien avant-gardiste de la synth-pop, un virtuose classique et un acteur à l’occasion. Surnommé affectueusement « Le Professeur » (Kyoju) par ses fans japonais en hommage à sa rigueur intellectuelle et à sa formation académique poussée à l’Université nationale des beaux-arts et de la musique de Tokyo (renommée aujourd’hui université des arts de Tokyo), Sakamoto a incarné la modernité musicale et un certaine évolution de la musique avec une profondeur rarement égalées.
L’éveil d’un prodige : formations classiques et influences telluriques
Né le 17 janvier 1952 dans l’arrondissement de Nakano à Tokyo, Ryūichi Sakamoto grandit dans un milieu intellectuellement vivifiant. Son père, éditeur littéraire, l’initie très tôt aux œuvres des grands écrivains japonais, forgeant chez le jeune garçon une sensibilité culturelle aiguë. Pourtant, c’est le piano, entamé dès l’âge de trois ans, qui devient son premier vecteur d’expression.
Son éducation musicale est un creuset d’influences. Dès l’adolescence, il s’imprègne de la musique classique occidentale, en particulier de la musique impressionniste de Claude Debussy, dont les harmonies et les structures tonales laisseront une marque profonde sur sa propre écriture. Simultanément, la révolution musicale des années 60, portée par les mélodies entêtantes des Beatles et l’énergie brute des Rolling Stones, nourrit son appétit pour le rock et la pop.
C’est donc à l’Université nationale des beaux-arts et de la musique de Tokyo que sa formation culmine. Il y étudie la composition et, de manière cruciale, l’ethnomusicologie. Cette discipline très intellectualisante, qui explore les musiques des cultures non occidentales, le sensibilise aux sonorités « d’ailleurs » – notamment la musique traditionnelle d’Okinawa, d’Inde et d’Afrique – qui infuseront sa future carrière en solo. Ces études, conjuguées à une fascination naissante pour les synthétiseurs Buchla et Moog, alors avant-gardistes, lui confèrent ce statut d’érudit capable de théoriser la musique avant de la déconstruire et de la réinventer.
Chez YMO, on avait l’habitude de porter des masques !
L’ère Yellow Magic Orchestra (YMO) : le triumvirat des sons du futur
L’ascension fulgurante de Ryūichi Sakamoto sur la scène internationale est indissociable de la formation, en 1978, du groupe Yellow Magic Orchestra (YMO). Aux côtés de Haruomi Hosono (basse/claviers/composition), à l’initiative de la création du groupe, et de Yukihiro Takahashi (batterie/chant), Ryūichi Sakamoto (claviers/composition) fera partie d’un trio qui va redéfinir la musique électronique.
Le contexte est idéal. Le Japon est en pleine effervescence technologique, et l’accès à de nouveaux synthétiseurs leur permet de canaliser l’influence des pionniers allemands comme Kraftwerk et d’y injecter une dose de funk, de disco et de mélodies japonaises excentriques. YMO n’est pas qu’un groupe de musique ; c’est un manifeste culturel. Les membres se produisent souvent dans des uniformes futuristes, incarnant une vision ironique et avant-gardiste de l’ère numérique émergente.
Leur premier album éponyme connaît un succès immédiat, mais c’est l’album Solid State Survivor (1979) qui les propulse sur la scène mondiale. Des titres comme Computer Game/Firecracker ou Behind the Mask (repris plus tard par Michael Jackson et Eric Clapton) sont des jalons de l’électro-pop. YMO n’a pas seulement prédit la musique du futur : il l’a créée. Leur mélange hyper-synchronisé de rythmes de boîte à rythmes, de lignes de basse funky et de mélodies synthétiques perçantes est directement à l’origine de l’explosion de la techno, du hip-hop et de la J‑pop. De Depeche Mode à Air, l’influence de YMO dans la musique des années 80 à 2000 est des plus importantes.
Le groupe, officiellement mis en pause en 1983 (avec des réunions sporadiques sous le nom de HASYMO), permit à Ryūichi Sakamoto (qui avait déjà sorti des album solos depuis 1978 et collaborer artistiquement avec d’autres artistes dès 1975) de capitaliser sur sa renommée, tout en le libérant de la formule pop pour explorer des territoires sonores plus vastes. L’expérience YMO lui a enseigné la puissance de la machine, une connaissance qu’il emportera dans ses projets les plus académiques.
C’est cette même année de 1983 qu’il commence à composer pour le cinéma (nous y reviendrons plus tard dans le texte) et qu’il entame quelques participations au cinéma.
La métamorphose musicale : du synthétiseur à la partition orchestrale
Après l’euphorie électronique de YMO, Ryūichi Sakamoto entame une phase de métamorphose radicale. Au lieu de se reposer sur la formule du succès, il préfère naviguer entre les genres avec notamment un retour aux instruments acoustiques, au piano et à l’orchestration, affirmant son identité de compositeur classique nourri par l’expérimentation électronique.
Ses projets solos de cette période sont une mosaïque d’explorations. Il s’essaie au rock progressif, au rap (avec l’album Neo Geo en 1987), à la bossa nova (Casa en 2001) et à la musique ambient expérimentale (notamment avec ses collaborations avec l’artiste autrichien Alva Noto). Ryūichi Sakamoto prouve que sa virtuosité ne réside pas dans un genre, mais dans sa capacité à extraire l’essence mélodique de n’importe quel idiome sonore.
Mais c’est peut-être le cinéma qui lui a offert le meilleur terrain d’expression pour ses nouvelles ambitions orchestrales. L’écriture de bandes originales exige la maîtrise d’une vaste palette émotionnelle, depuis l’intimité d’une mélodie au piano jusqu’à la puissance d’une symphonie. C’est dans ce domaine qu’il rencontrera, après YMO et malgré la grande qualité de sa carrière solo, son plus grand succès, notamment en collaborant avec des réalisateurs de renom comme Bernardo Bertolucci, Pedro Almodóvar, Brian De Palma, Yōji Yamada, Takashi Miike, Alejandro González Iñárritu ou bien encore Hirokazu Kore-eda pour une dernière danse (et sans oublier encore une fois Nagisa Ōshima avec Tabou en 1999).
Œuvres emblématiques pour le septième art
La carrière de Ryūichi Sakamoto est jalonnée de distinctions prestigieuses qui témoignent de son impact sur le monde de la musique et bien plus encore. Le sommet de sa reconnaissance académique et populaire est certainement atteint avec sa composition pour le film épique de Bernardo Bertolucci, Le Dernier Empereur (The Last Emperor, 1987), pour laquelle le compositeur japonais est accompagné de David Byrne et de Cong Su.
Pour cette œuvre monumentale, Ryūichi Sakamoto remporte l’Oscar de la meilleure musique de film, un Golden Globe et un Grammy Award. Des morceaux comme Rain sont des leçons de composition, où une mélodie simple se développe en une fresque émotive.
Sa filmographie de compositeur est un catalogue d’œuvres marquantes parmis lesquels on peut citer Un thé au Sahara (The Sheltering Sky, 1990), en collaboration avec Richard Horowitz, où la bande son dépeint les vastes paysages et la mélancolie existentielle du désert ; Little Buddha (1993), une œuvre méditative et spirituelle ; ou bien encore The Revenant (2015), une musique écrite en collaboration avec Alva Noto cité précédemment et Bryce Dessner, telle une toile sonore brute et immersive reflétant la violence et l’isolement du paysage.
Subjectivité et perles musicales
Si Le Dernier Empereur lui a valu un Oscar, c’est une œuvre antérieure, et que nous avons préféré garder pour la fin, qui a véritablement cimenté sa réputation de musicien capable de capturer la tragédie humaine avec une rare délicatesse : Merry Christmas, Mr. Lawrence (ou Furyo) en 1983 réalisé par Nagisa Oshima.
Pour ce film, Ryūichi Sakamoto n’a pas seulement composé la musique ; il a joué le rôle troublant du Capitaine Yonoi, le commandant du camp de prisonniers fasciné par le Major Celliers (David Bowie). Le thème principal, Merry Christmas, Mr. Lawrence, est devenu la signature émotionnelle de l’artiste, une mélodie d’une poésie déchirante. C’est l’incarnation de la compassion retenue : une phrase musicale répétitive au piano, enrichie de synthétiseurs en arrière-plan, qui exprime à la fois la mélancolie, la tendresse cachée et l’indicible douleur de la guerre et de la répression des sentiments.
À l’opposé du lyrisme de Merry Christmas, Mr. Lawrence, je voulais mettre en exergue la musique de Tony Takitani (2005), réalisé par Jun Ichikawa et adapté d’une nouvelle de Haruki Murakami, qui n’est pas la plus connue de ses compositions et qui pourtant révèle une autre facette de sa sensibilité. Cette partition est un chef-d’œuvre de minimalisme mélancolique. Elle utilise principalement le piano seul ou quelques cordes feutrées, instillant un sentiment de vide et de solitude qui reflète l’existence d’un homme obsédé par la réplication et l’absence. Cette musique illustre parfaitement la capacité de Sakamoto à réduire son langage musical à son expression la plus pure, pour atteindre une profondeur émotionnelle maximale.
Les dernières notes ou l’apogée d’un son minimaliste
La dernière décennie de la vie de Ryūichi Sakamoto fut marquée par un courageux combat contre la maladie. Après avoir été diagnostiqué d’un premier cancer en 2014, puis d’un deuxième en 2020, il a continué à composer avec une urgence et une intensité renouvelées. Cette période a donné naissance à une œuvre plus introspective, axée sur la beauté des sons naturels et la simplicité de l’existence.
L’album Async (2017) est assurément le manifeste de cette nouvelle ère. C’est un travail expérimental et ambient qui explore les textures sonores, les bruits d’ambiance et les sons trouvés (field recordings). L’artiste y cherche à capturer la « musique que l’on ne peut pas jouer », en intégrant des sons de verre brisé, de pluie ou de vieux synthétiseurs défectueux. Son album est une réflexion sur la temporalité, la fragilité et la finitude, souvent décrit comme le testament musical du compositeur.
Dans les années qui précède son crepuscule, la performance publique est devenue une rareté. Il sonne un dernier concert filmé en 2022, sobrement intitulé Ryuichi Sakamoto : Playing the Piano 2022 (dont vous avez pu apprécier le titre Merry Christmas, Mr. Lawrence plus haut). Devant un piano unique dans une pièce dépouillée, Sakamoto a interprété ses œuvres emblématiques dans un style épuré, chaque note résonnant avec une clarté et une gravité poignantes. Ce fut un adieu sans artifice, le triomphe de la mélodie pure sur le tumulte du monde et la souffrance du corps.
Ryūichi Sakamoto s’éteint le 28 mars 2023 et laisse alors un héritage immense comme son talent. Son parcours, depuis les expérimentations électroniques de YMO jusqu’à son minimalisme final, offre une leçon à méditer : l’art véritable serait-il un dialogue constant entre tradition et avant-garde, entre la technologie et l’âme humaine ? Par sa réponse que fut sa vie musciale, Le Professeur nous aura enseigné que la puissance émotionnelle vient peut-être tout simplement d’une note juste. Et qu’elle fut juste cette note !