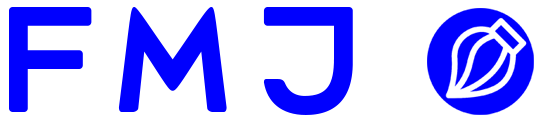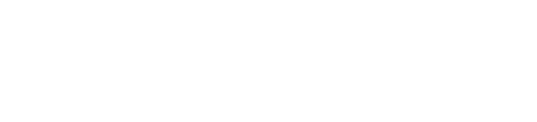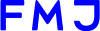Xin Dongwang (1963–2014) est une figure majeure et profondément humaniste de la peinture à l’huile chinoise contemporaine. Disparu prématurément à l’âge de 50 ans, il a laissé une marque indélébile en devenant le portraitiste de la Chine en mutation de ces quatre dernières décennies.
Il est célèbre pour s’être éloigné de l’art purement académique et s’être concentré sur les travailleurs migrants (mingong), capturant ainsi leurs espoirs et leurs difficultés avec une empathie rare.
 © Xin Dongwang
© Xin Dongwang Une jeunesse dans la ruralité profonde
Né en 1963 dans le petit village de Xinjiafang, situé dans le comté de Kangbao, dans la province du Hebei (au Nord de la Chine), Xin Dongwang a connu l’ascèse d’une région aride, difficile et très pauvre, frontalière de la Mongolie intérieure. Sa famille, constituée de paysans, connait la faim et le froid des hivers du Nord. Dès son plus jeune âge, il est donc imprégné par la rudesse de la vie paysanne, une expérience qui forgera son empathie indéfectible pour les travailleurs agricoles et ces gens qui ont leurs mains comme outils de travail.
Et contrairement aux artistes issus des grandes académies urbaines, Xin Dongwang a commencé au bas de l’échelle, comme artisan. Après le lycée, vers 1980, il quitte son village natal pour tenter sa chance plus au nord, en Mongolie intérieure, dans le comté de Huade. Pour gagner sa vie, il ne commence pas par faire de l’art avec un grand A, mais de la décoration utilitaire. Le jeune homme devient un peintre itinérant. Il va de village en village pour peindre des décorations sur les kangs (espace servant de lieu de vie comme de lit, en briques habituellement) et sur du verre. Cette période est fondamentale : en vivant chez l’habitant, Xin Dongwang mangeait avec ces familles de peu et peignait pour eux. Il a appris à observer les visages tannés par le soleil et les mains usées par le travail bien avant d’apprendre l’anatomie académique.
 © Xin Dongwang
© Xin Dongwang Ascension artistique et sociale
Son talent brut finit par être remarqué, et il parvient à s’extraire de sa condition par l’éducation, un parcours du combattant pour un jeune rural à l’époque.
Il réussit à intégrer le département d’art de l’École Normale de Jinzhong (1986–1988) située dans la province voisine du Shanxi. C’est sa première véritable formation académique structurée. Il y apprend les bases du dessin classique et de la peinture à l’huile. Après en être sorti diplômé, Xin Dongwang enseigne la peinture à l’Université normale du Shanxi. C’est une réussite sociale majeure pour un fils de paysan… mais il ne s’arrête pas là ! Insatisfait de son niveau technique, il vise plus haut et part se perfectionner à la prestigieuse Académie centrale des beaux-arts de Chine (à Pékin) au milieu des années 90. C’est là qu’il confronte son expérience rugueuse de la vie rurale aux techniques les plus sophistiquées de la peinture occidentale et fait également face à ses camarades chinois qui ont une approche contemporaine éloignée de son vécu. C’est également à ce moment où il expérimente d’une certaine manière la vie de mingongs, puisque c’est un rural, avec peu de moyens, qui s’intègre peu à peu à la vie urbaine, au milieu d’une communauté artistique de haute volée.
Un style des plus singuliers
À son arrivée dans la capitale, il ne loge donc pas dans des dortoirs confortables. Il vit dans les villages urbains périphériques, là où logent justement les travailleurs de la construction et les petits commerçants venus des campagnes.
Xin Donwang loue des chambres minuscules, mal chauffées l’hiver (l’hiver est rude à Pékin), économisant chaque centime pour acheter de la peinture et des toiles afin de commencer sa carrière. Cette précarité n’était pas un choix artistique, mais une nécessité économique. Cependant, elle l’a maintenu en contact direct avec ses sujets. Il mangeait dans les mêmes échoppes de rue que les ouvriers, prenait les mêmes bus bondés. Il partageait leur anxiété de l’avenir et leur sentiment d’exclusion face à la richesse ostentatoire de la ville.
Xin Dongwang racontait qu’à cette époque, il se sentait maladroit, pas à sa place. Il ressentait physiquement la pression de la ville ; une forme de pression physique et psychologique qui sera à l’origine de ce style singulier où il peint les corps légèrement tassés ou déformés. Cette distorsion n’est pas une caricature, c’est la traduction visuelle de ce qu’il ressent : le poids de la société qui pèse sur les épaules des migrants, les comprimant littéralement dans l’espace urbain.
De plus, il est également un ambassadeur du néoréalisme, clé de voûte de son art, qui se manifeste dans ses œuvres par une puissance visuelle inouïe. Doté d’une acuité pénétrante, l’artiste traverse les apparences pour saisir instantanément la dimension spirituelle de ses modèles. Il capture le moindre détail avec une précision chirurgicale — un regard vacant, des lèvres entrouvertes, des narines frémissantes, une posture gauche ou une chaussure avachie — révélant ainsi l’essence même de l’âme. Cette maîtrise confère à ses personnages une force viscérale qui émeut et marque durablement la mémoire.
Mais il ne cherche pas à imposter un patos quelconque. Au contraire, ses toiles sont plutôt humanistes et chaleureuses. Xin Dongwang évoque même vouloir peindre la chaleur de la peau, de la chair et la « température » de l’âme. Des caractéristiques plutôt optimistes, empathiques avec lesquelles l’observateur de ses peintures ressent une connexion directe, presque physique, avec les sujets desdistes peintures.
 © Xin Dongwang
© Xin Dongwang  © Xin Dongwang
© Xin Dongwang 2004–2014 : la dernière décennie
L’apogée de sa carrière arrive peut-être à l’âge de 41 ans lorsqu’il devient professeur à l’Académie des Arts et du Design de l’Université Tsinghua en 2004. Tsinghua est souvent considérée comme l’équivalent du MIT ou de Harvard en Chine. Pour un homme né dans un village pauvre du Hebei, sans éducation secondaire formelle classique au départ, devenir professeur titulaire dans cette institution est une réussite sociale inouïe. C’est à ce moment précis, alors qu’il atteint le sommet du confort et du statut social, qu’il peint avec le plus d’intensité les travailleurs migrants. Il ne s’est pas embourgeoisé dans son art. Au contraire, sa position lui a donné la liberté totale de peindre ce qu’il voulait, sans concession.
Ses oeuvres, à l’instar de celles de son compatriote Liu Xiaodong, recueillent alors la reconnaissance de ses pairs et des galeristes. Sa maturié artistique est atteinte. Il continue de produire énormément jusqu’à ce que la maladie (un lymphome) l’emporte en 2014, à seulement 50 ans, un âge jeune pour un peintre, notamment un peintre comme Xin Dongwang qui n’avait pas encore de fini de donner au monde des nouvelles de la Chine contemporaine.
Malgré son ascension sociale et culturelle, il a su garder son cœur (et son pinceau) fidèle aux « petites gens ». Témoin d’une Chine à fleur de peau, Xin Dongwang a été la conscience visuelle d’une urbanité à tout crin en préservant la mémoire de ceux qui l’ont bâti. Et pour saisir cela, trois toiles peuvent servir de témoigagnes : À la lisière de la ville (Chengshi Bianyuan) : l’œuvre manifeste qui l’a révélé, exposant la précarité brute des migrants ; Petit-déjeuner (Zaodian) : une ode à la vie quotidienne, capturant l’instant trivial du repas avec une monumentalité sacrée ; et enfin Noces d’or (Jinhun) : un témoignage bouleversant sur le temps qui passe et la persistance des liens humains malgré la rudesse de la vie.
 © Xin Dongwang
© Xin Dongwang