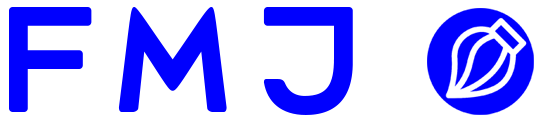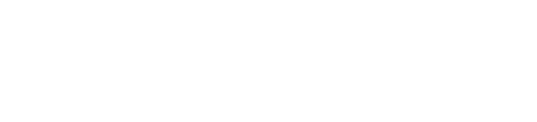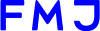Dans le monde feutré des galeries d’art et des salles de vente aux enchères, certaines œuvres ne se contentent pas d’être belles ou révolutionnaires ; elles atteignent des sommets financiers vertigineux, défiant l’imagination. Si la peinture accapare souvent les gros titres avec ses records mondiaux, la sculpture, elle, n’est pas en reste. Formes abstraites, figures élancées, icônes pop audacieuses ou vestiges d’une antiquité lointaine : ces créations tridimensionnelles captivent collectionneurs et investisseurs en quête d’un trésor inestimable.
Mais quelles sont ces pièces d’exception qui ont fait flamber les enchères ? Quelles histoires se cachent derrière ces chiffres qui donnent le tournis ? Voici le Top 10 des sculptures les plus chères jamais vendues.
n°10
Tête de Femme (Dora Maar) Pablo Picasso
Cette sculpture représente Henriette Theodora Markovitch, plus connue sous le nom de Dora Maar (1907–1997). Elle fut une photographe surréaliste de talent, peintre, poète… mais également l’une des maîtresses et muses les plus importantes de Picasso pendant une décennie, de 1936 à 1946. Leur relation était passionnée, intense et souvent tumultueuse, marquée par les tensions de la Seconde Guerre mondiale et l’évolution personnelle et artistique des deux figures. La Tête de Femme (Dora Maar) est un exemple parfait de la capacité de Picasso à utiliser la distorsion et la fragmentation (héritées du cubisme) non pas pour une simple expérimentation formelle, mais pour exprimer un état intérieur, une psyché tourmentée. Les traits sont reconnaissables mais remodelés, reflétant la dualité et la souffrance.
 © Succession Picasso
© Succession Picasso Découvrez le prix…
n°9
Tulips Jeff Koons
Les Tulips font partie de la série des Celebration de Jeff Koons, qui comprend également ses célèbres Balloon Dogs. Comme beaucoup de ses œuvres, elles imitent l’apparence de tulipes gonflables, mais sont en réalité fabriquées en acier inoxydable lourd et poli avec une précision industrielle. Les premières versions de Tulips remontent aux années 1990 (1995–2004). Le Bouquet of Tulips pour Paris a été conçu après les attentats de 2015.
 © Christie’s
© Christie’s Découvrez le prix…
n°8
Jim Beam – J.B. Turner Train Jeff Koons
Que ferait-on sans Jeff Koons ? Il ne s’agit ici pas du superbe train de la série Ricky où la belle vie mais plutôt d’un décanteur de bourbon Jim Beam en forme de train, fait de porcelaine et de plastique à l’époque, que l’artiste découvrit dans la vitrine d’un magasin d’alcool à New York et qu’il reproduisit à sa manière. Jeff Koons a voulu transformer cet objet de collection populaire et « prolétarien » en une œuvre d’art luxueuse et durable, en le refondant en acier inoxydable poli. L’inclusion du bourbon à l’intérieur de chaque wagon est cruciale pour l’œuvre. D’ailleurs il s’agit de bourbon Jim Beam. Koons a contacté la compagnie pour qu’elle remplisse les wagons et appose le timbre fiscal. Le train est la pièce maîtresse de sa série Luxury and Degradation. À travers cette série, Koons explorait comment le luxe et la publicité peuvent à la fois séduire et potentiellement « dégrader » les individus (dont ici la dépendance à l’alcool est un parallèle qu’il fait avec cette dégradation de la société).
 © Jeff Koons
© Jeff Koons Découvrez le prix…
n°7
Hurting the Giant (Bleeding Stone) Louise Bourgeois
Les sculptures d’araignées de Louise Bourgeois sont sans doute ses œuvres les plus emblématiques et les plus reconnaissables, et elles sont chargées de significations personnelles et symboliques profondes. Elles ont captivé l’imagination du public et sont devenues des icônes de l’art contemporain. La plus célèbre reste certainement Maman. Elles ont commencé à apparaître dans son œuvre dans les années 1990, alors qu’elle était déjà une artiste âgée (1911–2010). Elles sont souvent massives, certaines atteignant plus de 9 mètres de hauteur ; celle-ci étant d’une hauteur de 3 mètres.
 © Sotheby’s
© Sotheby’s Découvrez le prix…
n°6
Nu de dos, 4 états (relief n°IV) Henri Matisse
C’est l’une des séries sculptées les plus ambitieuses et les plus longues de Matisse. Il a commencé le premier Nu de dos en 1909 et n’a terminé le quatrième qu’en 1930, soit plus de deux décennies de travail intermittent. Cette durée exceptionnelle montre à quel point ce projet était central pour ses explorations artistiques, même si la sculpture restait pour lui un domaine secondaire par rapport à la peinture.
Elle est est contemporaine de certaines de ses peintures les plus importantes, comme La Danse et La Musique. On peut y voir les échos des préoccupations de Matisse concernant la simplification, le rythme et l’équilibre des formes dans ces deux médiums.
 © Succession H. Matisse
© Succession H. Matisse Découvrez le prix…
n°5
Grande tête mince Alberto Giacometti
La Grande tête mince est une illustration parfaite de la manière dont Alberto Giacometti percevait le monde. Il ne cherchait pas à reproduire fidèlement ce qu’il voyait, mais plutôt la « vision immédiate et affective » des choses. Comme il le disait : « Quand un personnage est vu de près, on le regarde de bas en haut et de haut en bas, sans pouvoir tenir compte de sa largeur. » Ceci explique l’allongement extrême des formes.
 © Sotheby’s
© Sotheby’s Découvrez le prix…
n°4
Lionne de Guennol
Il s’agit là d’une petite sculpture antique (à peine 8cm de hauteur), dont la date de création se situe environ entre 3000 et 2800 av. J.-C. (Proto-Élamite, Mésopotamie). Cela la place à une époque clé de l’histoire humaine, contemporaine de l’invention de la roue, du développement de l’écriture cunéiforme et de l’émergence des premières cités. Le matériau utilisé est du calcaire cristallin ou magnésite.
On pense qu’elle a été trouvée près de Bagdad, en Irak, mais les détails précis de sa découverte sont inconnus. La sculpture représente une figure anthropomorphique, mi-humaine mi-lionne. Elle est debout, musculeuse, avec un corps aux courbes féminines et une tête de lionne détaillée et expressive. Ses pattes sont jointes sur son abdomen. Elle dégage une impression de force et de détermination.Il s’agirait de l’un des derniers chefs-d’œuvre connus de l’aube de la civilisation encore dans les mains d’un collectionneur privée..
 © DP
© DP Découvrez le prix…
n°3
The Rabbit Jeff Koons
Il existe une série de trois sculptures Rabbit identiques, plus une épreuve d’artiste. Rabbit fait partie d’une série d’œuvres de Jeff Koons des années 1980 qui explorent l’idée du « kitsch » et du « prêt-à-porter » transformés en objets d’art de luxe. Cette série interroge les notions de goût (CQFD), de valeur et de statut social. L’artiste reprend ici une tradition initiée par Marcel Duchamp avec ses « ready-made », mais il va plus loin en transformant l’objet banal avec un matériau plus spectaculaire (acier inoxydable poli). En effet, la surface miroitante du Rabbit est une caractéristique clé de l’œuvre. Elle invite le spectateur à se refléter dans l’œuvre, le rendant ainsi partie intégrante de la sculpture. Jeff Koons parle de « l’affirmation du spectateur ». Le lapin gonflable évoque l’enfance, l’innocence et la fantaisie. Cependant, la froideur et la dureté de l’acier inoxydable, combinées à l’absence de traits faciaux et l’apparence « déflationnée » (malgré l’illusion d’être gonflé), confèrent au Rabbit une qualité énigmatique, voire légèrement menaçante ou vide. Il peut être perçu comme ludique et joyeux, mais aussi comme creux et artificiel.
 © Jeff Koons
© Jeff Koons Découvrez le prix…
n°2
L’Homme qui marche Ier Alberto Giacometti
C’est l’une des sculptures les plus emblématiques du 20e siècle, une figure filiforme et solitaire qui incarne la condition humaine et les interrogations existentielles de l’après-guerre. Date de conception : 1960. Matériau : Bronze. Il fait partie d’une série de plusieurs Hommes qui marchent et est souvent considéré comme l’apogée de la recherche de Giacometti sur la figure humaine en mouvement. Avec une dimension d’environ 180,5 cm de hauteur, sa taille réelle le rend d’autant plus imposant malgré sa maigreur.
La sculpture a été conçue à l’origine pour un projet de commande publique pour la Chase Manhattan Plaza à New York, qui n’a finalement pas été réalisé. L’idée était de créer un groupe de figures humaines marchant dans un espace urbain.
Cette création est souvent vu comme une métaphore puissante de la condition humaine après les horreurs des deux guerres mondiales. Décharnée, elle symbolise la fragilité, la solitude et la résilience de l’individu face à l’absurdité de l’existence. L’homme est en marche, un pas en avant, les bras le long du corps ou légèrement décalés. Ce mouvement est à la fois déterminé et infini, sans destination finale apparente. Il incarne l’idée d’un voyage constant, d’une quête incessante. Aussi, il n’a ni âge, ni vêtement, ni attributs spécifiques qui l’ancreraient dans une époque ou une identité particulière. Il est « l’Homme » avec un grand H, symbolisant l’humanité toute entière.
 © Succession Giacometti
© Succession Giacometti Découvrez le prix…
n°1
L’Homme qui pointe du doigt Alberto Giacometti
Le 11 mai 2015, l’un des exemplaires de L’Homme qui pointe du doigt devient la sculpture la plus chère jamais vendue aux enchères et l’œuvre d’art la plus chère jamais vendue aux enchères (record qui a depuis été dépassé par des Selon une anecdote célèbre racontée par Giacometti lui-même, il aurait créé cette sculpture en une seule nuit. Il aurait travaillé frénétiquement pour la terminer à temps pour son exposition de 1948 à la galerie Pierre Matisse, après avoir détruit ou remanié de nombreuses autres pièces. La période d’après-guerre a profondément marqué Giacometti. Il a vécu l’Occupation à Paris et la Libération. Ses figures maigres et solitaires sont souvent vues comme une réponse directe à la dévastation et à l’aliénation ressenties après les conflits mondiaux. L’Homme qui pointe du doigt est une méditation sur la fragilité de l’existence. Giacometti était un ami proche du philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre, qui a écrit des textes importants sur son œuvre, notamment La recherche de l’absolu. Sartre a vu dans les figures de Giacometti une incarnation de ses propres théories sur la liberté, l’angoisse et la solitude de l’être humain.
 © A. Giacometti
© A. Giacometti