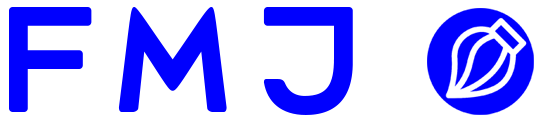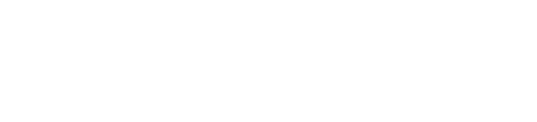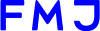Les femmes artistes au XIXᵉ sècle
À la fin du XIXᵉ siècle, le monde de l’art en France est un bastion essentiellement masculin, tournant autour de l’Académie des Beaux-Arts et de « son » Salon officiel. Dans ce système, les femmes artistes sont quasiment vues comme des figures exotiques ou de simples amatrices (si ce n’est des figures comme Elisabeth Vigée-Lebrun au XVIIIᵉ siècle, Rosa Bonheur au XIXᵉ). Elles font face à des obstacles majeurs et systématiques. En premier lieu, l’accès à l’éducation. En effet, les femmes étaient interdites d’accès à l’École des Beaux-Arts de Paris jusqu’en 1897. Par conséquent, elles ne pouvaient pas suivre une formation complète et officielle, notamment l’étude de l’anatomie à partir du nu masculin, considérée comme la base de la peinture d’histoire, un genre noble, voire perçu comme le plus prestigieux d’entre tous.
Mais il y a également la notion de « génie créateur ». L’artiste était perçu comme un « génie » prenant l’apparence d’un homme souvent solitaire, dans son atelier, dont la créativité et la force étaient considérées comme intrinsèquement masculines. Les femmes, elles, étaient souvent cantonnées aux rôles de modèles, de muses ou d’amatrices, dont les créations, si elles avaient l’outrecuidance d’être artistes, étaient vues comme une simple activité de loisir, et non comme un métier. Il leur était extrêmement difficile de s’arracher de cette perception patriarcale, encore plus lorsque le rapport de maître (homme) à élève (femme) entrait en jeu.
Et puis, pour ne rien arranger à cela, les femmes ont été victimes d’une forme de hiérarchie des genres. Elles étaient encouragées, pour celles qui entrevoyaient une lueur de succès, à se limiter à des genres dits « mineurs » ou « féminins » comme la nature morte, la peinture de fleurs, ou le portrait (souvent d’enfants ou de femmes). Aborder des sujets historiques, politiques, religieux ou mythologiques était ainsi une prérogative quasi exclusivement masculine.
 © Wikipédia
© Wikipédia
Et la SNBA fut !
C’est dans ce contexte que la Société Nationale des Beaux-Arts (SNBA) va créer une brèche décisive, bouleversant les codes pour faire des femmes des actrices à part entière du monde de l’art.
En effet, face à un système rigide et académique, la SNBA, initialement créée en 1862 puis refondée en 1890, entre en rupture avec cette ligne traditionnelle et vient, dès la première édition de son Salon la même année, le Salon des Beaux-Arts, faire une place de choix aux femmes, avec plus de dix pour cent d’artistes exposés issus du beau sexe (et dire qu’elles représentent aujourd’hui une majorité au Salon des Beaux-Arts… que de chemin parcouru !).
La SNBA devient alors une plateforme de visibilité et de légitimité. Son Salon offre aux femmes un lieu d’exposition de premier plan, au même titre que pour leurs homologues masculins. En y exposant dès les premières années, des artistes comme Suzanne Valadon ou Camille Claudel ont pu présenter leur travail à un large public et aux critiques, gagnant ainsi en légitimité professionnelle sans être considérées comme des « curiosités ».
C’est aussi la possibilité pour les femmes d’intégrer ses instances de pouvoir et c’est sans doute l’apport le plus révolutionnaire. La SNBA n’a donc pas seulement permis aux femmes d’exposer, elle les a intégrées à sa structure même ! On peut évoquer brièvement les membres fondatrices comme Madeleine Lemaire et Louise Catherine Breslau (médaillée d’or à l’Exposition universelle de 1889) qui faisaient partie des 184 membres fondateurs de la SNBA en 1890. Cela leur a conféré un statut de « sociétaire », leur donnant ainsi des droits de vote et de décision sur l’orientation de la Société. Elles ont été également membres du jury. En 1893, Madeleine Lemaire et Louise Abbéma sont devenues les premières femmes à siéger au jury du Salon de la SNBA. C’était un événement majeur : elles avaient le pouvoir de juger le travail de leurs pairs masculins, remettant en cause l’autorité masculine traditionnelle dans l’appréciation artistique.
 © Wikimedia — D.Paccellieri
© Wikimedia — D.Paccellieri © Musée d’Orsay — D.Paccellieri
© Musée d’Orsay — D.Paccellieri © Pompidou — D.Paccellieri
© Pompidou — D.Paccellieri © BNF — D. Paccellieri
© BNF — D. Paccellieri © RMN-GP — D.Paccellieri
© RMN-GP — D.PaccellieriAinsi, la SNBA a permis de graver dans le marbre la reconnaissance de leur travail dans tous les genres de la peinture. En étant plus ouverte sur le plan artistique, la Société a donné la possibilité aux femmes artistes de s’exprimer dans des genres où seuls les hommes étaient autorisés. Camille Claudel a d’ailleurs pu exposer ses sculptures, des œuvres d’une force et d’une puissance qui contredisaient alors les stéréotypes sur la « délicatesse féminine ».
Agissant comme un puissant catalyseur d’égalité, elle a créé un contre-modèle à l’académisme en offrant aux femmes un espace où leur talent était jugé sur le fond et non sur le genre. Ce faisant, la SNBA a non seulement mis en lumière des artistes exceptionnelles, mais elle a aussi contribué à fissurer le modèle du « génie masculin » et à jeter les bases d’une plus grande équité dans le monde parfois cruel de l’art à partir du XXᵉ siècle (cruel, car souvenons-nous du destin de certaines femmes artistes, épousant la misère à la fin de leur vie ou étant internées comme Camille Claudel et Juana Romani).
Bonus : deux précieuses archives
La première est l’exposition rétrospective de portraits de femmes signés entre 1870 et 1900 (hommes et femmes peintres confondus) par la SNBA en 1907 au Palais du Domaine de Bagatelle ; et qui accompagne, à sa manière, les luttes féministes de l’époque.
La deuxième est médiatique puisque le grand Guillaume Apollinaire prend la plume et la trempe dans l’encre pour écrire un article, paru dans le journal Le Petit Bleu de Paris, le 5 avril 1912 en première page (colonnes centrales), afin de saluer les « peintresses », dont la plupart ont exposé au Salon.